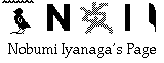
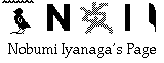
Ḍākinī et l’Empereur 1
Introduction Retourner à la Table des Matières
Connaissez-vous ces affreuses fées qui sont appelées ḍākinī...?
Ce sont des démones cannibales qui, dans la mythologie hindoue, sont considérées comme de fidèles acolytes de la déesse Kālī, grande Déesse Noire, ou Déesse du Temps. Une ḍākinī figure dans la célèbre sculpture de Śiva domptant l’asura Andhaka, du temple-grotte No 15 d’Ellora(1). On y voit la démone ailée voltigeant au-dessus de Kālī (nommée en l’occurrence Yogeśvarī), laquelle tend une coupe pour recevoir les gouttes de sang qui s’écoulent du corps de l’asura empalé par le trident du dieu dompteur ; la ḍākinī, tel un oiseau de proie, est affamée, et attend que sa maîtresse lui donne à sucer sa part de sang...
L’origine et la nature de ces ḍākinī restent bien obscures(2) ; la racine sanscrite ḌĪ signifiant “voler, voltiger”, on peut présumer que ce sont des démones volantes ; mais ce point mis à part, la seule chose un peu certaine à leur sujet est qu’elles sont des êtres magiques effrayants, fées craintes et vénérées, un peu de la même manière que d’autres divinités féminines de rang inférieur, comme par exemple les yoginī ou les “Mères” (mātṛ, ou mātaraḥ au pluriel). — Or, ces ḍākinī, ayant été incorporées dans la mythologie du bouddhisme ésotérique, furent connues en Chine et au Japon ; et dans ce dernier pays, elles changèrent de nature : le mot ḍākinī, qui était à l’origine un nom générique désignant une catégorie de démones, devient une sorte de nom propre d’une divinité plus ou moins individualisée(3), qui reçoit le titre de “dieu” ou plutôt de “déesse” (ten 天) — c’est pourquoi, nous écrirons ci-dessous, quand il s’agit du culte japonais, “Dakini-ten”, de préférence à une ou des ḍākinī. Cette Dakini-ten, donc, fut assimilée à une divinité indigène appelée Inari 稻荷 et fut le plus souvent imaginée sous la forme d’un renard. Et au cours du Moyen âge, elle fut l’objet d’une vénération si particulière qu’elle en est venue pour ainsi dire à “présider” une des cérémonies les plus secrètes et les plus mystérieuses du bouddhisme médiéval japonais, à savoir la cérémonie bouddhique d’intronisation des empereurs (appelée “sokui-kanjō 即位灌頂”, c’est-à-dire “Abhiṣeka [Onction] d’intronisation”). Les raisons de cette transformation et de cette “apothéose” extraordinaires restent en partie obscures ; mais quelques études extrêmement savantes et intéressantes ont été consacrées à ce sujet ces dernières années au Japon(4). Nous essayerons dans les pages qui suivent d’examiner ce problème, en insistant surtout sur la cohérence des transformations, de l’Inde jusqu’au Japon, de certains thèmes mythiques qui semblent avoir joué un rôle important à l’arrière plan de cette évolution des croyances japonaises ; ce sera aussi pour nous une occasion d’entrevoir le côté sombre de la “mystique” du pouvoir impérial qui s’est formée peu à peu pendant le Moyen âge, et dont le Japon d’aujourd’hui reste sans doute encore quelque peu tributaire.
* *
En réalité, le sujet est très étendu, et il est impossible de le traiter dans toute son ampleur. Notre essai se présentera plus particulièrement comme un commentaire développé sur un très petit passage d’un texte d’une grande importance : il s’agit du chapitre sur Dakini-ten du Keiran-shūyō-shū 溪嵐拾葉集 ou “Recueil des Feuilles ramassées au Val embrumé”, compilé entre 1311-1348 par un moine de l’Ecole Tendai 天台 nommé Kōjū 光宗. Cet ouvrage, rempli de toutes sortes d’informations les plus curieuses et les plus précieuses sur l’état des croyances et des doctrines du Moyen âge japonais, comporte un chapitre sur Dakini-ten, où une petite section est consacrée aux traditions relatives à l’abhiṣeka (Onction) d’intronisation ; et à la fin de cette section se trouve cette phrase(5) :Dans le Sūtra du Roi Bienveillant (Renwang-jing 仁王經), [il est question de] «Rendre culte au dieu de cimetière [en offrant] cela» ; c’est à cela qu’il faut penser profondément.C’est à la signification de cette phrase énigmatique que nous essayerons de “penser profondément”.
1. Antécédents hindous et bouddhiques Retourner à la Table des Matières
A. Mythe et iconographie du Śiva hindou soumettant l’asura Andhaka Retourner à la Table des Matières
Mais avant d’en venir à aux développements proprement japonais des croyances relatives aux ḍākinī, il convient d’étoffer quelque peu le contexte mythique dans lequel elles apparaissent dans l’hindouisme et le bouddhisme. Pour cela, il est peut-être bon de commencer par examiner le mythe de la soumission de l’asura Andhaka par Śiva que la sculpture d’Ellora, mentionnée tout à l’heure, est censée représenter(6).Un jour que Śiva et son épouse Pārvatī s’ébattaient sur le mont Mandara, Pārvatī couvrit par jeu les trois yeux de Śiva avec ses mains. Du coup, le monde s’obscurcit totalement (car, selon un commentaire, les yeux de Śiva sont le soleil, la lune et le feu) ; les mains de Pārvatī transpirèrent à cause de la chaleur du front de son époux, et de cette transpiration naquit un démon horrible, tout noir et aveugle, nommé pour cela Andhaka, “l’Aveugle”.Ce mythe, œdipéen par excellence, explique l’apparition de plusieurs motifs iconographiques importants : le groupe des Sept (ou Huit) śakti (appelées le plus souvent “Mères”) ont apparu à cette occasion ; c’est aussi lors de cette soumission que Śiva executa une de ses danses célèbres ; le personnage squelettique (connu sous le nom de Bhṛṅgin) qui figure souvent parmi les adorateurs de Śiva n’est autre qu’Andhaka ayant été “purifié” par le dieu ; enfin et accessoirement, la peau d’éléphant dont Śiva se couvre est expliquée ici comme ayant été la dépouille de Nīla-asura tué par Vīrabhadra (mais il est possible que ce mythe du meurtre de Nīla-asura ait été à l’origine sans rapport direct avec celui d’Andhaka, et qu’il y ait été greffé un peu artificiellement).
Juste à ce moment, le roi des démons (asura) Hiraṇyākṣa, “les Yeux d’Or”, dévot de Śiva, se livrait à l’ascèse pour obtenir un fils. Śiva, l’ayant su, alla auprès de lui et lui donna ce bébé-démon. Il savait cependant que ce petit démon ferait du mal dans l’avenir, et promit à Hiraṇyākṣa qu’il “purifierait” alors le corps de son fils adoptif.
Hiraṇyākṣa mourut bientôt, tué par Viṣṇu, et Andhaka devint à son tour le roi des asura. Il se livra à de terribles austérités, en sacrifiant chaque jour dans le feu un peu de sa propre chair et un peu de son propre sang, si bien qu’il devint bientôt tout squelettique. A la fin, le dieu Brahmā vint en hâte pour accorder le souhait de l’asura, car sans cela, le monde n’aurait pu supporter la puissance de sa terrible ascèse. L’asura demanda alors une vie éternelle, qu’il ne soit tué par aucun être, ni même par Viṣṇu ou par Śiva ; Brahmā dut lui expliquer que toute créature née doit mourir un jour. Alors, à la place de ce souhait, le démon en formula un autre, bien curieux : que la plus excellente des femmes devienne comme sa propre mère, et que, si jamais il lui arrivait de la désirer, qu’il soit tué par ce fait même. Brahmā fut étonné par ce souhait, mais le lui accorda, et lui remit de plus la part de sa chair et de son sang qu’il avait sacrifiée — de sorte que le démon recouvra son corps ancien.
Après ses austérités, Andhaka devint extrêmement puissant ; comme tout roi des asura, il était très violent et avait un appétit érotique extraordinaire. Il soumit le monde entier et toutes les belles femmes étaient les siennes, lorsque, un jour, un de ses ministres trouva dans le mont Mandara un ascète tout particulier, ayant sur son diadème un croissant de lune, etc. (c’était Śiva) et, près de lui, une femme ravissante, la plus belle du monde. Le ministre rapporta la chose à son roi, et celui-ci, devenu fou et “aveugle” de désir pour cette femme, somma l’ascète Śiva de la lui donner (ou selon une autre version, Andhaka vit un jour Śiva et Pārvatī en leur union sexuelle ; il devint fou de désir pour cette femme...). — La guerre éclate entre le dieu et l’asura ; les détails sont longs et divergents selon les versions. Il faut cependant en retenir quelques uns qui ont trait à l’iconographie de Śiva connue sous le nom d’Andhakāsura-vadhamūrti (forme de la soumission d’Andhaka-asura), dont l’un des exemples les plus connus est justement la sculpture du temple-grotte No 15 d’Ellora. Śiva était donc prêt à partir au champ de bataille en se parant de trois serpents célèbres, Vāsuki, Takṣaka et Dhanaṃjaya, l’un comme ceinture et deux autres comme bracelets. Or, à ce moment, un asura nommé Nīla (le Bleu), en prenant la forme d’un éléphant, s’approcha du dieu pour le tuer secrètement. Le gardien du palais de Śiva Nandin s’en aperçut, et avertit un autre gardien appelé Vīrabhadra. Celui-ci se transforma en un lion (ennemi naturel d’éléphant) et tua l’asura. Il présenta la peau de l’asura-éléphant à son maître qui fut tout réjoui et s’en couvra comme une sorte de cuirasse pour partir à la guerre. D’autres grands dieux vinrent aussi avec leurs armées pour porter secours à Śiva. Celui-ci réussit à blesser le roi des démons avec son arc et sa flèche et de cette blessure s’écoula abondamment du sang. Cependant, tombé sur le sol, chaque goutte du sang d’Andhaka se transforma en un autre Andhaka, et des milliers de petits Andhaka magiques vinrent attaquer les dieux. Alors Viṣṇu s’occupa de ces Andhaka magiques, et Śiva empala avec son trident le cœur du vrai roi des asura ; pour arrêter que les gouttes de son sang touchent la terre, Śiva créa du feu de sa bouche une śakti (énergie féminine) nommée Yogeśvarī (“Maîtresse du Yoga”) ; les autres dieux créèrent aussi leur śakti, à savoir Brahmāṇī, Māheśvarī, Kaumārī, Vaiṣṇavī, Vārāhī, Indrāṇī et Cāmuṇḍā. Toutes ces sept déesses (ou huit en tout avec Yogeśvarī) ayant bu le sang de l’asura blessé, et arrêté ainsi la multiplication infinie des petits Andhaka, Śiva dansa dans sa joie furieuse ; il hissa au haut le roi des démons empalé, et mille années durant le brûla avec le feu de son troisième œil. Andhaka, tout desséché, devint complètement squelettique, mais tout son péché ayant été consummé, il se repentit et demanda pardon à Śiva. Il prit refuge en Śiva ; celui-ci l’accepta avec joie et le donna à Pārvatī comme son fils. Andhaka devint ainsi un grand adorateur du couple divin, et il eut le titre de chef de leur troupe (gaṇeśatva)...
On voit aussi par ce mythe le contexte dans lequel apparaît la ḍākinī dans la sculpture du temple-grotte No 15 d’Ellora. D’après la description donnée par T. A. Gopinath Rao, cette sculpture représente principalement : au centre, un Śiva furieux, fendu à gauche, ayant huit bras ; les deux bras du devant portent le trident au bout duquel est empalé, tout en haut, l’asura Andhaka, déjà tout squelettique et adorant le dieu en joignant les deux mains ; les deux mains supérieures de Śiva tiennent et tendent à l’arrière la peau d’éléphant dont il se couvre ; les autres mains portent l’une une coupe crânienne (kapāla) dans lequel le dieu reçoit le sang du démon, une autre un tambour et une autre une épée ; la dernière main fait le geste de menace en étendant l’index ; sous le pied gauche de Śiva est représenté un petit atlante (ou une déesse ?), qui le porte sur ses mains et sa tête(7) ; à gauche du dieu, accroupie sur le sol même, on voit la śakti de Śiva, Yogeśvarī (Kālī), horrible vieillarde décharnée aux seins pendants ; elle a deux longs bras ; la main gauche, tendue vers le haut, porte une coupe dans laquelle elle reçoit les gouttes du sang d’Andhaka ; l’autre main tient un poignard courbe ; et au-dessus de cette déesse voltige la ḍākinī, moitié humaine, moitié oiseau, comme on l’a indiqué plus haut ; enfin, à gauche de Kālī, à la mi-hauteur, se trouve assise Pārvatī, la jambe droite repliée et la jambe gauche pendante, regardant avec frayeur le terrible combat qui se déroule devant elle(8).
* *
B. Transposition sino-japonaise de l’iconographie de Śiva soumettant l’asura Andhaka Retourner à la Table des Matières
D’une manière tout à fait inattendue, cette scène semble se retrouver — très déformée, il est vrai — dans un maṇḍala bouddhique japonais : il s’agit du maṇḍala appelé “Maṇḍala des Déesses-Mères” qui représente graphiquement la Section XIII du Prajñāpāramitā-naya-sūtra (plus connu au Japon sous le titre de “Rishu-kyō 理趣經”)(9). Ce sūtra, célèbre à la fois par la philosophie extrêmement “quintessenciée” qu’il enseigne et son contenu très “osé” (interprété littéralement, il exalterait tout simplement la pratique de l’union sexuelle, dont la jouissance ne serait autre que la Grande Joie, mahāsukhā, de l’Eveil bouddhique(10)), a été commenté par le grand maître indien d’ésotérisme, Amoghavajra (705-774), qui a travaillé au VIIe siècle en Chine comme traducteur. La Section XIII du Naya-sūtra est consacrée à une Formule qu’offrirent les “Sept Mères-Déesses” au Buddha(11). — Dans son commentaire, Amoghavajra indique d’emblée que ces “Sept Mères-Déesses font partie de l’entourage du dieu Mahākāla [Mahākāla, dont il sera beaucoup question ci-dessous, est le nom d’une forme terrible de Śiva]”. Comme chaque section de ce sūtra, celle-ci doit être représentée par un maṇḍala. Amoghavajra l’expose ainsi :Ces Déesses ont aussi leur maṇḍala : au centre, on dessine Mahākāla, entouré par les Sept Mères-Déesses ; les détails sont ainsi qu’il est enseigné dans le Sūtra en large. “Mahākāla” : c’est le Sens du Grand-Temps ; le Temps, ce sont les Trois moments [le passé, le présent et le futur] ; [le qualificatif] “Grand”, c’est le Sens de n’avoir aucun obstacle : [ainsi,] c’est le Corps d’Essence du Buddha Mahāairocana, qui n’a aucun lieu où il ne pénètre.Au Japon, le groupe des “Sept Mères-Déesses” est constituée traditionnellement par : 1. Cāmuṇḍā, 2. Kauverī, 3. Vaiṣṇavī, 4. Kaumārī, 5. Aindrī, 6. Raudrī et 7. Brāhmī(13). En réalité, la liste des “Mères-Déesses” a toujours été flottante depuis l’Inde même (il pouvait exister même un groupe de “Seize Mères-Déesses”)(14) ; malgré les noms des grandes divinités qui leur sont attribués, on peut penser que c’est un groupe de déités féminines assez peu distinctes, appelées “Mères” surtout parce qu’étant capables d’envoyer des maladies aux enfant et de les tuer, le peuple leur rendait culte pour qu’au contraire, elles les protègent(15). “Vénérées parce que craintes” : ce caractère ambivalent est commun à bien des divinités hindoues ou bouddhiques, mais c’est particulièrement frappant dans le cas du culte des “Mères-Déesses” ou des ḍākinī ou encore de Kālī.
Les Sept Mères-Déesses, avec la Mère-Déesse Brāhmī, représentent ensemble les Huit Bodhisattva de Culte.
[Ainsi,] par le Phénoménal est manifesté le Principiel(12).
Le fait que ce maṇḍala met en scène ces “Mères-Déesses” entourant une forme terrible de Śiva, semble déjà le rapprocher du mythe hindou de la soumission d’Andhaka, puisqu’il expliquait justement l’apparition de huit śakti autour de Śiva combattant, mais ce qui est plus remarquable encore est le nom et l’iconographie de ce personnage central : Mahākāla, le dieu “Grand (mahā) Noir (kāla)” ou “Grand Temps (kāla)” (kāla en sanskrit a ces deux sens). Le nom de Mahākāla, qui est grammaticalement la forme masculine de “Mahākālī”, apparaît en effet dans certaines descriptions de l’iconographique de Śiva domptant l’asura Andhaka : il est dit par exemple dans le Chapitre LIX du Viṣṇudharmottara :On doit créer une forme [de Śiva] ayant de grands yeux ronds de la couleur du feu, avec un gros ventre, une face terrible par ses crocs, [...] orné de tous côtés de serpents effrayants, inspirant de l’effroi à Pārvatī par le serpent et par la peau d’éléphant dont il se couvre, ressemblant par sa couleur aux nuages lourds de pluies [...]. Cette forme, fendue de gauche, est dite être la forme de Bhairava, alors que vue de front, elle est nommée Mahākāla(16).Le trait de la “couleur des nuages lourds de pluies” est à retenir, puisque le célèbre poète Kālidāsa, dans son “Messager des Nuages”, compare le Śiva du temple nommé Mahākāla à Ujjainī aux nuages gros d’orage du soir(17). — Du point de vue iconographique, le Mahākāla se trouvant au centre du maṇḍala des “Mères-Déesses” du Naya-sūtra peut être décrit de la manière suivante : c’est une divinité courroucée à trois tête et à six bras, torse nu, assise avec les jambes croisées. Son corps est de couleur bleue-noire. Ses longs cheveux sont hérissés et les trois têtes sont couronnées de crânes humains. La tête principale a trois yeux et a des crocs apparents. Il se pare d’une guirlande faite de deux serpents qui pendent à son cou. Il porte aussi des enfilades de calottes crâniennes. Ses bras sont ornés de bracelets faits de serpents qui s’y nouent. Des deux mains principales, il tient une épée à l’horizontale sur les genoux. L’extrémité de la poignée de cette épée est en forme de trident (les pointes étant du côté droit). La seconde main droite saisit un petit personnage par les cheveux ; celui-ci est nu, les mains jointes, et est à genoux. La seconde main gauche saisit les cornes d’un bélier blanc dont les membres pendent. Des deux dernières mains, il étend une peau d’éléphant sur le dos, comme s’il allait s’en couvrir(18). Cette forme, identique à celle de Mahākāla dans le Maṇḍala de la Matrice (Taizō-mandara 胎藏曼荼羅) du Mahāvairocana-sūtra (objet de culte dans l’Ecole japonaise d’ésotérisme Shingon-shū 眞言宗), semble être fondée elle-même sur un texte iconographique chinois qui a été écrit selon l’enseignement donné par Amoghavajra (il s’agit d’un passage d’un glossaire composé entre 788-810 par un disciple chinois d’Amoghavajra, Huilin 慧琳 ; ce passage se rapporte à une “traduction” [en fait un apocryphe] faite par Amoghavajra lui-même, le Renwang-jing 仁王經 ou le Sūtra du Roi Bienveillant [c’est le sūtra qui était cité par le Keiran-shūyō-shū mentionné plus haut]) :[Mahākāla] a une grande puissance surnaturelle et vit d’innombrables mille années. Il a huit bras ; son corps est bleu-noir, couleur des nuages. Des deux mains principales qu’il repose devant la poitrine, il porte horizontalement un trident ; la deuxième main droite saisit un bélier bleu ; la deuxième main gauche tient le chignon d’un esprit revenant (gaki 餓鬼, preta) ; la troisième main droite porte une épée et la troisième main gauche tient un khaṭvāṅga (c’est un mot sanskrit qui signifie une bannière de calottes crâniennes). Les deux mains à l’arrière sont chacune sur une épaule, et tendent une peau d’éléphant blanc, comme s’il allait s’en couvrir. Au moyen d’un serpent venimeux, il enfile des calottes crâniennes et en fait une guirlande. Ses crocs de tigre dépassent [sur sa lèvre] supérieure. On le représente dans un aspect de grande colère. Des éclairs et de la fumée [l’entourent] comme une auréole ; la forme de son corps est extrêmement grande. Sous ses pieds, il y a une Déesse-génie de Terre (Pṛthivī ?), qui porte ses pieds sur ses deux mains(19).On voit qu’il y a quelques différences entre l’iconographie décrite par ce texte et celle de la représentation graphique de Mahākāla dans le maṇḍala des “Mères-Déesses” (ou le Maṇḍala de la Matrice) ; le dieu a six bras dans celle-ci alors qu’il doit en avoir huit d’après le texte de Huilin (de même que le Śiva-Mahākāla du temple-grotte d’Ellora) ; au lieu de l’épée que porte le Mahākāla de la représentation graphique, il doit tenir un trident selon le texte (comme le dieu dans le temple indien) ; enfin, le texte ne précise pas la posture générale du dieu, mais l’indication selon laquelle il a sous ses pieds une “Déesse-génie de Terre” qui le supporte sur ses mains, peut suggérer qu’il devait être représenté debout, alors que dans les maṇḍala japonais, il est figuré assis avec les jambes croisées (et la “Déesse-génie de Terre” n’y est pas représentée). Ainsi, il semble bien que dans l’ensemble, l’iconographie du texte de Huilin — qui est sans doute à la base de la représentation graphique du maṇḍala et donc plus ancienne que celle-ci — soit plus proche de l’iconographie hindoue de la soumission d’Andhaka par Śiva. Par ailleurs, selon un commentaire conservé en tibétain du Naya-sūtra, le Mahākāla du centre du maṇḍala des “Mères-Déesses” doit être figurée avec dix bras, et dans une posture “dansante”(20) — ce qui rappelle de nouveau un trait important du Śiva hindou dans son aspect de la soumission d’Andhaka-asura.
On peut relever encore d’autres correspondances entre ce Mahākāla décrit par le texte de Huilin (ou celui du maṇḍala des “Mères-Déesses”) avec le Śiva dans son “Andhakāsura-vadhamūrti” : la plus frappante est la peau d’éléphant que l’un et l’autre porte à leurs mains supérieures ; on se rappelle aussi la “couleur des nuages” commune aux deux figures. Moins apparent, mais tout aussi important est le fait que, selon le texte de Huilin, le dieu est dit être porté par une “Déesse-génie de Terre”, alors que, en ce qui concerne Śiva dans l’iconographie hindoue, on trouve accroupie à ses pieds la figure de Kālī. Or, dans la mythologie hindoue, comme l’écrit M. Biardeau, “quand, au sujet d’une femme mythique [...], on insiste sur son teint noir, on peut soupçonner que non seulement la signification «Déesse» affleure, mais aussi celle de «Terre»”(21) ; Kālī étant la déesse “Noire” par excellence, la “Déesse-génie de Terre” sous les pieds du Mahākāla du texte de Huilin peut certainement être considérée comme la reflétant en quelque mesure.
Ainsi, on peut bien croire que, malgré le fait qu’Amoghavajra lui-même n’en était probablement pas conscient, le Mahākāla du maṇḍala japonais des “Mères-Déesses” du Naya-sūtra dérive de quelque manière du Śiva hindou dans son “Andhakāsura-vadhamūrti”, et que l’«esprit revenant» qui est porté par une main de ce Mahākāla correspond à l’asura Andhaka empalé dans l’iconographie hindoue (seul, le trait du “bélier bleu” [selon le texte ; bélier blanc dans les représentations japonaises] porté par une autre main de Mahākāla reste inexpliqué par les références à ce mythe hindou ; mais le bélier étant un attribut fréquent dans d’autres aspects du Śiva hindou(22), il est possible de penser qu’il s’y est glissé d’une manière adventice).
Si l’on accepte cette hypothèse, quelques petits problèmes historiques peuvent recevoir de la lumière à leur tour : d’une part, on peut être certain que le mythe et l’iconographie de la soumission d’Andhaka-asura par Śiva était constitués avant les activités d’Amoghavajra en Chine, c’est-à-dire vers le début du VIIIe siècle (ce qui n’est pas étonnant, puisque les grandes sculptures hindoues d’Ellora ou d’Elephanta sont généralement estimées comme datant à peu près de la fin du VIe siècle ou du début du VIIe siècle) ; d’autre part, comme nous l’avons déjà dit, la représentation du Mahākāla du centre du maṇḍala des “Mères-Déesses” étant identique à celle du même dieu dans le Maṇḍala de la Matrice du Mahāvairocana-sūtra, on pouvait se demander laquelle des deux a précédé l’autre ; mais si l’on accepte que cette iconographie repose de quelque manière sur celle du Śiva hindou dans son aspect de la soumission d’Andhaka, on doit penser que la figure du maṇḍala des “Mères-Déesses” est certainement plus proche de l’original, puisque Mahākāla y est entouré par les Huit “Mères-Déesses” qui sont des éléments importants dans le mythe de cette soumission.
* *
2. Ḍākinī dans le bouddhisme ésotérique : le tantrisme tardif et le tantrisme chinois Retourner à la Table des Matières
Revenons maintenant aux ḍākinī et voyons de quelle manière elles ont été reçues et incorporées dans le bouddhisme. En inversant l’ordre chronologique, nous dirons d’abord un mot sur les ḍākinī dans le bouddhisme ésotérique tardif, c’est-à-dire le tantrisme indo-tibétain après le VIIIe ou le IXe siècle. Selon une explication de Snellgrove, “ḍākinī” dans le tantrisme indo-tibétain est plus ou moins synonyme de yoginī : or le mot yoginī lui-même est équivoque, puisqu’il peut signifier d’une part une certaine catégorie de fées démoniaques féminines, bien proches des ḍākinī précisément, et d’autre part les femmes ascètes adeptes du yoga (simple forme féminine de yogin). Dans le tantrisme indo-tibétain, ḍākinī peut désigner d’abord les yoginī-ascètes avec lesquelles les yogin (appelés alors ḍāka, forme masculine de ḍākinī) s’assemblent à des fêtes secrètes sur des lieux sacrés : en se conformant à des rituels stricts, ces yogin hommes et femmes prennent de la nourriture (qui peut comprendre de l’urine, de l’excrément, du sang, du sperme et de la chair humaine ; l’ensemble est appelé les Cinq Ambroisies), boivent des liqueurs, chantent et dansent, et enfin s’unissent (en réalité, tout cela peut être [ou parfois doit être] pris comme relevant d’un langage purement symbolique). Dans la Grande Joie qui résulte de cette assemblée-union (saṃvara), les yogin hommes et femmes s’identifient les uns à Heruka et les autres à sa parèdre Vajravārāhī. — D’autre part, et probablement en rapport avec cet usage du mot, le même mot ḍākinī peut désigner les déesses les plus importantes, comme les Cinq yoginī (Nairātmyā, Vajrā, Vāriyoginī, Gaurī et Vajraḍākinī) en union avec les (ou identifiées aux) Cinq Buddha suprêmes (Akṣobhya, Vairocana, Amitābha, Ratnasambhava, et Amoghasiddhi), union qui représente l’unité ultime de l’existence (saṃvara). Dans l’iconographie, les ḍākinī sont figurées comme des déesses farouches, de couleur noire, ornées de Cinq Sceaux (diadème, ornements d’oreilles, collier, bracelets et ceintures) ; elles ont un seul visage aux yeux flamboyants, et deux mains qui portent à droite un couperet et à gauche une coupe de crâne ; elles ont aussi un khaṭvāṅga qui repose contre leur épaule gauche ; vêtues de la peau de tigre autour des reins, elles se tiennent sur des cadavres étendus(23).
Tout cela relève d’une recherche expresse de l’horrible, du violent, de l’érotique ou de l’impur, qui est caractéristique de certaines formes du tantrisme bouddhique et qui peut être considéré comme le résultat d’une volonté de dépassement de toute norme sociale et de toutes les oppositions discursives. Que le mot ḍākinī désigne des compagnes des ascètes avec lesquelles ils s’unissent à la fin des fêtes extatiques, ou qu’il signifie des déesses suprêmes, il a été choisi sans doute dans le même esprit de “renversement des valeurs”, à cause de la connotation mythique d’«horrible, effrayant, macabre»... que le terme pouvait avoir dans le contexte hindou.
En revenant maintenant à la forme du tantrisme plus ancien, connue surtout par les traductions chinoises de l’époque des Tang, on constate d’abord que dans l’ensemble, les ḍākinī y sont très peu mentionnées. En fait, il n’y a pratiquement qu’un seul texte d’une certaine longueur où il soit question d’elles. Mais ce texte, qui est un passage du chapitre sur le “Trésor des Formules communes” du Commentaire sur le Mahāvairocana-sūtra (Dainichi-kyō 大日經, c’est-à-dire “Sūtra du Buddha Grand-Soleil“ si l’on traduit littéralement son titre usuel ; ce commentaire a été écrit par le moine Yixing 一行 avant 727, en collaboration avec le traducteur du sūtra, Śubhakarasiṃha) a eu une importance capitale en ce qui concerne les développements des croyances et du culte des ḍākinī (ou de Dakini-ten) au Japon. Il s’agit d’un mythe dans lequel le Buddha Mahāvairocana, transformé en Mahākāla, chef naturel des ḍākinī, soumet ces dernières en les mangeant, parce qu’elles mangent “le cœur” des hommes qui mourront dans six mois. Ce mythe, typique des mythes tantriques de soumissions en ce que “le dompteur se comporte de manière idoine au dompté” (c’est-à-dire si le dompté est violent, le dompteur se fait plus violent que lui ; si le dompté est luxurieux, le dompteur se fait plus luxurieux, etc.), est raconté comme une explication de la Formule des ḍākinī donnée dans le texte du Sūtra (dans la traduction qui suit, nous omettons quelques répétitions)(24) :Ensuite, la Formule des ḍākinī :Le Mahāvairocana-sūtra et son commentaire par Yixing ont été sans doute parmi les ouvrages les plus lus et les plus étudiés dans toute l’histoire du Japon (le Catalogue des textes bouddhiques annexé à l’édition Taishō du Canon énumère quelque 144 commentaires ou sous-commentaires relatifs à ces textes(26), mais ce n’est certainement pas tout...) ; et cependant, le caractère hâtif et peu soigné de la rédaction du commentaire de Yixing est bien connu de tous (c’est ce qui est appelé dans l’Ecole Shingon les “désordres de texte” et qu’elle explique pieusement comme ayant été voulu exprès par l’auteur, pour que les enseignements secrets ne soient pas divulgués imprudemment aux profanes, mais on tiendra cette explication pour ce qu’elle vaut(27)). Dans le récit qui vient d’être traduit, on peut voir un exemple de ces “désordres de texte” : les ḍākinī sont dès le début censées connaître l’«art magique» par lequel elles peuvent reconnaître six mois à l’avance les hommes qui vont mourir ; or, à la fin du récit, le Buddha leur enseigne une Formule (et un Sceau — mais celui-ci n’est décrit que dans un chapitre ultérieur(28)), qui ne font que double emploi avec cet “art” qu’elles possédaient déjà...
Dans le monde, il y en a ceux qui pratiquent cet art magique et qui ont la Maîtrise dans l’art des Charmes : [ce sont les ḍākinī]. Elles sont capables de reconnaître les hommes qui vont mourir ; six mois [à l’avance], elles les reconnaissent, et les ayant reconnus, pratiquent cette méthode : elles prennent leur cœur (xin/sin 心) et le mangent. Si elles font ainsi, [c’est parce qu’]il y a dans le corps humain [une sorte de] «jaune» : c’est ce qu’on appelle le «jaune d’hommes» (ninnō 人黄), comme il y a le «jaune de vaches» (goō 牛黄, sk. gorocanā, “orpiment jaune fait avec de la bile de vache” [Stchoupak, Nitti et Renou, Dictionnaire Sanskrit-Français, Paris, 1959, s.v. gorocanā](25)) ; celles qui en mangent sont rendues capables des plus grandes Réussites magiques (sk. siddhi) : [n’ayant aucun obstacle ni pour ciculer dans les airs ni pour marcher sur l’eau], elles peuvent aller en une seule journée dans les Quatre Régions, et peuvent obtenir tout selon leurs désirs. De plus, elles peuvent dominer de diverses façons les hommes ; ceux qui les ont en aversion, elles les soumettent, en leur faisant subir les extrêmes affres de maladie. Or, par cet art, [les ḍākinī] ne peuvent pas tuer les hommes ; il leur est nécessaire de procéder par elles-mêmes à l’art magique [de la prévision] ; en reconnaissant les hommes qui vont mourir dans six mois, elles prennent leur cœur par magie. Ayant pris [ainsi] leur cœur, il leur faut remplacer [le cœur] par une autre chose, [ce qui fait que] ces hommes ne meurent pas [tout de suite] ; lorsqu’arrive le moment de la rencontre avec la mort, alors, ils sont [soudain] détruits.
En général, ce sont des des yakṣiṇī ayant la grande Maîtrise ; elles appartiennent à Mahākāla, c’est-à-dire le Génie Grand-Noir.
[Le Buddha] Mahāvairocana, ayant voulu exorciser ces démones par la Rubrique de la Loi de la Soumission des Trois Mondes (Triloka-vijaya), se transforma magiquement en le Génie Grand-Noir [= Mahākāla], et manifesta d’immenses apparitions qui les dépassaient [infiniment]. Il s’enduisit le corps de cendre, et, se rendant dans la jungle (sk. aṭavī, “terre en friche”), convoqua par magie toutes les ḍākinī. Et il les réprimanda [en ces termes] : «Puisque vous mangez toujours les hommes, de même, maintenant, je vous mangerai !» Et il les avala [d’un coup] ; cependant, il ne les fit pas périr, et, les ayant soumises, il les relâcha en leur faisant promettre de s’abstenir de toute [nourriture] carnée. Elles dirent alors : «Nous obtenons toutes d’être en vie en nous nourrissant de la chair ; maintenant, comment pouvons-nous nous maintenir en vie ?» Le Buddha leur dit : «Je vous permets de vous nourrir du cœur des hommes morts.» Elles lui dirent : «Quand les hommes sont sur le point de mourir, les grands yakṣa, sachant que leur vie s’épuise, viennent à qui le premier les manger ; comment pourrions-nous alors obtenir [le cœur de ces morts] ?» Le Buddha leur dit : «Je vous enseignerai une Formule et un Sceau, [qui vous permettront de] reconnaître six mois à l’avance ceux qui vont mourir ; les ayant reconnus, vous les protègerez par magie, de sorte que ceux-ci n’aient pas crainte d’être endommagés ; et lorsque leur vie vient à s’épuiser, j’admets que vous les preniez et les mangiez.»
C’est ainsi que [le Buddha put] les amener petit à petit à entrer dans la Voie [correcte]. C’est pourquoi, il y a cette Formule : «Hrīḥ haḥ». [Cette Formule] exorcise la souillure de cet art pervers [des ḍākinī].
Quoi qu’il en soit, on remarquera que ces ḍākinī bouddhiques restent bien proches de leurs homonymes hindoues ; que leur chef soit Mahākāla est bien compréhensible à la fois parce que celui-ci est le correspondant masculin de [Mahā]Kālī, et aussi parce qu’il semble représenter le Śiva dans son aspect de la soumission d’Andhaka ; comme dans l’hindouisme, ces ḍākinī sont ogresses et hantent des lieux sinistres. Le texte dit qu’elles mangent “le cœur” des hommes qui vont mourir ; on ne sait pas exactement si l’énigmatique “jaune d’homme” qu’elles prennent est identique au “cœur” ou qu’il est une substance contenue en lui, mais il faut remarquer en tout cas que le mot “cœur” (xin 心, qui correspond sans doute au sk. hṛdaya) ne désigne pas nécessairement le cœur au sens anatomique mais peut signifier l’«essence» ou la «partie essentielle» de quelque chose.
En anticipant quelque peu notre propos, il est intéressant de citer ici un texte japonais du XIVe siècle qui semble refléter de très près ce récit du commentaire de Mahāvairocana-sūtra : on le trouve dans un ouvrage de rituels ésotériques dû à un certain Chōgō 澄豪 (1259-1350) de l’Ecole Tendai 天台, intitulé Sōji-shō 總持抄 ; il donne de plus une interprétation particulièrement intéressante du mot «jaune d’homme». Dans une section nommée «A propos de la [Méthode de] Prolongation de Six Mois», Chōgō écrit(29) :Autrefois, lorsque [le Buddha] était dans le Monde, il y avait Dakini-ten qui mangeait l’esprit vital (shōki 精氣) des Etres. Le Buddha ordonna au dieu Mahākāla de la soumettre ; alors le Chacal (yakan 野干) [= c’est-à-dire Dakini-ten(30)] dit au Buddha : «Je me maintiens en vie en mangeant de la viande ; si vous m’interdisez d’en manger, ce sera une cause de trancher [ma] vie.» Ainsi dit-elle en obéissant à la raison. Sa parole ayant été tout à fait [conforme à] la raison, [le Buddha dit :] «Alors, d’ici six mois, il y aura des hommes qui mourront ; tu pourras manger ceux-ci. La limite étant les six mois, tu pourras manger l’esprit vital [de ces hommes], mais il ne faut pas en manger d’autres.» Ainsi, suivant cet enseignement, la limite étant fixée à six mois, [Dakini-ten] mange l’esprit vital [de ces hommes]. Suivant cela, le Commentaire du Mahāvairocana-sūtre dit que ce grand yakṣa [ou plutôt yakṣiṇī ?] peut reconnaître les hommes qui vont mourir dans six mois, et leur prend le «jaune d’homme». [Ce «jaune d’homme»] se trouve dans le corps humain, comme le «jaune de vache» [dans le corps de vache], et ceux qui en mangent obtiennent les grandes Réussites magiques. Ce yakṣa [plutôt cette yakṣiṇī] appartient à Mahākāla (fin de citation).L’identification de Dakini-ten au “Chacal” (qui, à son tour, est identifié au Renard) semble être d’origine chinoise (cf. infra), mais c’est une croyance développée surtout dans la religion japonaise ; d’autre part, le fait que le Roi-de-Science Acala est dit être “le chef de Dakini-ten” semble être particulier à ce texte, mais peut s’expliquer parce que d’après certaines traditions japonaises, Mahākāla lui-même est identifié à Acala(31) (d’une façon plus lointaine, dans la mythologie hindoue, Acala est, comme Mahākāla, un des noms de Śiva). Mais ces points mis à part, on voit que dans l’ensemble, ce texte suit d’une manière assez fidèle le récit de la soumission des ḍākinī par Mahākāla.
Ceci est l’interprétation [du Commentaire] sur le mot “ḍākinī”. L’«esprit vital des Etres» : [c’est qu’]il existe dans le cœur [des Etres] sept grains de jade blancs (byakugyoku 白玉) de la forme des [gouttes de] rosée ; ces grains de jade se trouvent dans le cœur de chair à huit pétales (hachibun nikudan 八分肉團). Lorsque [Dakini-ten] commence à manger ces sept grains de jade, six mois après, la vie de cet Etre prend fin. Jusqu’au moment où elle commence à en manger, les prières et autres [rituels magiques] sont efficaces ; mais lorsqu’elle en a déjà mangé cinq ou six, alors, la force de tous les autres Vénérés est incapable d’atteindre [le but de la prolongation de la vie], sauf celle du Roi-de-Science Acala («l’Immobile», Fudō 不動), qui, la seule, peut retourner [la situation]. C’est ce qu’on appelle la «Prolongation des Six Mois». La «Prolongation de la Longévité» ne se dit pas seulement de la limite de six mois, mais de toute la vie. On appelle cela la «Méthode du retournement par les Actes fixes d’Acala». Acala est le chef du Chacal ; c’est pourquoi il peut soumettre le Chacal [et écarter son effet nocif] (interprété selon le sens).
Nous avons dit que le passage du Commentaire du Mahāvairocana-sūtra est pratiquement le seul texte du Canon chinois traitant un peu longuement des ḍākinī ; if faut cependant signaler un texte qui a pu avoir une grande influence au développement des croyances japonaises relatives aux ḍākinī (ou à Dakini-ten) : il s’agit de la grande dhāraṇī du Sinciput de Buddha Parasol Blanc, qui fut très connue au Japon, où est nommée ḍākinī dans une énumération d’Etres démoniaques. Or ce nom est glosé en chinois par “démon(e) de renard lutin” : “dakini 荼枳尼(ko-mi-ki 狐魅鬼)”. Bien que le texte où cette dhāraṇī apparaît pour la première fois en chinois, le “Sūtra Śūraṃgama du Tathāgata Grand Sinciput du Buddha” soit considéré comme un apocryphe, la dhāraṇī elle-même est sans doute d’origine indienne(32). Comme nous le verrons, l’identification de ḍākinī au Renard aura une grande importance dans le culte japonais de Dakini-ten / Inari ; or ce texte montre qu’une telle identification existait déjà en Chine, et que l’identification japonaise remonte peut-être à ce texte chinois.
D’autre part, il existe aussi un autre texte, émanant de l’enseignement d’Amoghavajra, qui, bien qu’il ne nomme pas les ḍākinī, est si proche par le contenu de du récit du Commentaire du Mahāvairocana-sūtra qu’il vaut la peine de le citer en entier. Il s’agit du commentaire, dû à un certain Liangbi 良賁, sur la “traduction” par Amoghavajra du Renwang-king.
Il faut expliquer le contexte. D’abord, ce Renwang-king est lui-même un apocryphe notoire : il a été sans doute composé en Chine vers le Ve ou le VIe siècle, sur la base de quelques textes qui avaient été traduits ; or, Amoghavajra l’a “retraduit” en 765 en collaboration avec une équipe de traducteurs, dont Liangbi faisait partie. Dans cette “retraduction” du Renwang-king, il y a un passage où le nom du “dieu Mahākāla du cimetière” est mentionné. Il s’agit d’une refonte d’un conte bien connu dans le bouddhisme : un prince nommé «Pieds Tachetés» (Kalmāṣapāda) est sur le point de monter au trône ; il consulte l’avis d’un maître hérétique qui est chargé de donner l’Onction au roi. Or, celui-ci lui ordonne d’«d’[aller] prendre les têtes de mille rois, pour les donner en offrande au Dieu-génie Mahākāla-Grand-Noir [habitant] dans le cimetière, [ce par quoi] il monterait naturellement au trône....» (dans l’ancienne “traduction”, il était écrit seulement «donner en offrande au dieu de la maison [royale]»). Le prince lui obéit et fait prisonniers 999 rois ; le millième roi qu’il attrape est nommé Samantaprabhāsa. Celui-ci consent à être sacrifié avec les 999 autres rois ; seulement, il demande un jour de sursis, parce qu’il avait promis à un moine bouddhique de lui faire du don. Le prince Kalmāṣapāda permet au roi de rentrer à son pays, pour éprouver s’il tiendra sa promesse. Samantaprabhāsa organise une grande fête d’aumône où il invite cent moines ; il apprend alors une stance bouddhique qui montre l’impermanence du monde. Le roi est tout réjoui, et revient de lui-même vers le prince exterminateur des rois. Ce dernier est étonné que le roi ait tenu la promesse et que de plus, il ait l’air tout joyeux. Il lui demande la raison, et à son tour, il apprend la stance sur l’impermanence du monde. Il se repent tout de suite, relâche les rois prisonniers et, en abdiquant la couronne en faveur de son frère cadet, quitte le monde pour entrer en religion...(33)
Dans le commentaire de Liangbi, composé sur l’ordre impérial, et basé sans doute sur l’enseignement d’Amoghavajra, on peut lire ce qui suit sur la phrase «Il lui ordonna d’[aller] prendre les têtes de mille rois, pour les donner en offrande au Dieu-génie Mahākāla-Grand-Noir [habitant] dans le cimetière» :Le Sūtra dit : «Il lui ordonna d’[aller] prendre les têtes de mille rois, pour les donner en offrande au Dieu-génie Mahākāla-Grand-Noir [habitant] dans le cimetière» :Bien que le texte ne nomme jamais ḍākinī, et qu’il ne spécifie pas le sexe des “génies-démons” sous l’ordre de Mahākāla, leur agissement paraît tellement semblable à celui des ḍākinī du Commentaire du Mahāvairocana-sūtra, qu’on est tenté de les considérer les uns et les autres comme de proches parents. En tout cas, nous le verrons ci-dessous, c’est ce que certains docteurs bouddhistes du Moyen âge japonais semblent avoir pensé. Mahākāla et son entourage hantent ainsi le champ de bataille ou des terrains sauvages, ou bien ils apparaissent dans le cimetière ; ils sont associés à une atmosphère sombre et horrible de magie noire, avec des cadavres, du sang et de la chair des hommes vivants, et des médecines magiques...
Explication : «Dans le cimetière», cela désigne l’endroit où habite [le Dieu]. [...] Ce Dieu-génie Grand-Noir [= Mahākāla] est un génie des combats. Si on le vénère, sa puissance s’augmente, et en tout ce qu’on entreprend, on remporte la victoire ; c’est pourquoi, on lui rend culte.
Comment peut-on le savoir ? Le Maître des Trois Corbeilles [Amoghavajra], citant un livre particulier en sanskrit, dit, en effet : Dans le Mahāmāyūrī-sūtra, il est dit(34) :
«A l’Est de la ville du pays Ujjayinī, il y a une forêt appelée Śmaśāna [“charnier”] — ce qui se dit ici [en langue chinoise] “Forêt des Cadavres” [Śītavana, qui est le nom d’un cimetière de Rājagṛha]. Cette Forêt a la longueur d’un yojana et autant de largeur. Il y a là le Dieu-génie Grand-noir : c’est un Corps de transformation de Maheśvara [“Grand Seigneur”, l’un des noms les plus communs de Śiva] ; il circule toujours de nuit dans la Forêt avec d’innombrables démons-génies qui sont ses acolytes. Ceux-ci [celui-ci ? — le sujet des phrases suivantes reste ambigu] possèdent une grande puissance surnaturelle et de nombreux trésors rares ; ils ont aussi une médecine qui dissimule la forme, et une médecine de longévité ; et ils circulent dans les airs. [En livrant leurs] médecines fantasmagoriques, ils trafiquent avec les hommes ; [mais] ils ne prennent en [contre-partie] que du sang et de la chair des hommes vivants. Ils se font promettre par avance un certain poids [de sang et de chair] et font le trafic des médecines et d’autres choses. Les hommes qui désirent s’y rendre se font d’abord [protéger] le corps par le Pouvoir sacramentel (sk. adhiṣṭhāna) de Charmes, et ensuite vont faire le trafic. A ceux qui ne [se protègent] pas par le Pouvoir sacramentel, ces démons-génies, en dissimulant leur forme, leur dérobent le sang et la chair, qui sont [par ce fait] diminués. Ils prennent ainsi [cette quantité de] sang et de chair sur le corps de ces hommes-là ; autant ils en prennent et autant cela diminue ; et pourtant, comme ils ne destinent pas [cette quantité de sang et de chair à l’accomplissement du] contrat préalable, ils en arrivent à la fin à prendre le sang et la chair de toute une personne, et le poids [promis à l’avance] n’ayant toujours pas été rempli, on ne peut obtenir aucune des médecines [désirées]. Ceux, [par contre,] qui se sont appliqués le Pouvoir sacramentel, peuvent trafiquer et obtenir des coquilles précieuses, des médecines et d’autres choses ; [alors,] tout ce qu’ils font se réalisera entièrement selon leurs désirs. Si l’on veut rendre culte [à ces démons-génies (ou à Mahākāla ?)], le sang et la chair d’hommes seuls [peuvent convenir]. Il [= Mahākāla, ou ils = les démons-génies ?] possède une grande force et protège les hommes, [dont] les actions seront vaillantes et farouches ; en matière de combats et autres choses [semblables] ces hommes remporteront toujours la victoire.»
C’est pourquoi, [on peut savoir que] le Dieu-génie Grand-Noir est un génie des combats.
C’est bien dans la même atmosphère que les ḍākinī font leur première apparition dans le bouddhisme japonais.
3. Ḍākinī dans le Maṇḍala de la Matrice du Mahāvairocana-sūtra Retourner à la Table des Matières
C’est dans le Maṇḍala de la Matrice du Mahāvairocana-sūtra que les ḍākinī apparaissent pour la première fois dans le bouddhisme japonais. Là, à côté du Roi de la Mort Yama, à la direction Sud de la Cour Extérieure, se trouvent figurées trois ḍākinī, portant des membres déchirés de cadavre, des coupes crâniennes remplies de sang et des poignards courbes ; l’une d’entre elles en particulier tient une jambe déchirée d’homme à sa main droite et est en train de la porter à la bouche, alors que l’autre main porte un bras déchiré. Devant elles, il y a un cadavre tout amaigri couché sur le sol même. Le fait qu’elles aient été représentées, non pas à côté de Mahākāla qui se trouve à la direction Nord-Est du Maṇḍala, mais près du Roi Yama, comme faisant partie de son entourage, est intéressant, parce que dans l’hindouisme déjà, Yama et Mahākāla semblent avoir eu des rapports étroits : sur le plan philosophique d’abord, on y distingue deux sortes de temps (kāla) : d’une part, le temps relatif, propre à chaque Etre, qui est mesuré par le moment de sa mort, et qui peut être représenté mythiquement sous la forme de Yama, et d’autre part, le temps absolu, qui n’a ni le commencement ni la fin, qui est le “Grand Temps”, c’est-à-dire Śiva sous son aspect de “Mahākāla”(35). Un autre rapport peut être décelé entre ces deux dieux : c’est que dans certains temples en Inde, Mahākāla, en tant que dieu gardien de porte, se trouve à gauche de la porte d’entrée avec la déesse fluviale Yamunā (à droite, il y a Nandīśa et Gaṅgā, de couleur claire et d’aspect serein ; Mahākāla et Yamunā sont au contraire de couleur sombre et d’aspect farouche) ; or, cette Yamunā est considérée comme la sœur et l’épouse du dieu de la Mort Yama ; de plus, elle figure parfois dans des listes d’ogresses (comme les ḍākinī) et de “Saisisseuses d’enfants” (grahī) (comme surtout la démone bouddhique Hārītī, qui est par ailleurs associée d’une manière très étroite à Mahākāla)(36).
Mais plus encore que ces antécédents lointains, il est intéressant de remarquer que, d’après la description du Maṇḍala de la Matrice dans le Mahāvairocana-sūtra, le Roi Yama devait être entouré par un groupe de Sept Mères-Déesses, de la déesse Kāla-rātri (la “Nuit Noire”, déesse de l’anéantissement cosmique, qui peut être considérée comme une forme de Kālī), et des animaux qui hantent les charniers, comme les corbeaux, des sortes de vautours, ou encore des chacals (écrit yegan 野干 dans le texte du Sūtra, hu 狐, “renard” dans le Commentaire)(37). On voit que ce petit “groupe infernal” avait un caractère nettement śivaïte, et que, plus particulièrement, il avait bien des éléments communs avec le groupe de la soumission d’Andhaka-asura par Śiva (si bien qu’en remplaçant ce Roi Yama par Mahākāla, on aurait eu un ensemble pratiquement identique à l’iconographie du Śiva Andhakāsura-vadhamūrti)(38). Or, dans le Maṇḍala de la Matrice tel qu’il a été dessiné et conservé de nos jours, ce groupe est composé différemment : il y a la déesse Kāla-rātri, un groupe de piśāca et de piśācī (autre catégorie de démons et démones cannibales), un fonctionnaire de l’enfer qui note les Actes de Bien et de Mal qu’a commis de son vivant un supplicié de l’enfer qui est à genoux devant lui (image mythique plus ou moins sinisée), et le groupe de trois ḍākinī. Bien que dans le Sūtra, la position de celles-ci dans le Maṇḍala n’ait pas été précisée, on voit que du point de vue de la logique mythologique, elles semblent bien être à leur place, dans l’entourage de Yama qui est ici tout pareil à Mahākāla.
L’auteur de l’un des premiers ouvrages systématiques japonais sur le Maṇḍala de la Matrice, le Shosetsu-fudōki, Shinjaku 眞寂 (886-927 ; le troisième fils, prince entré en religion, de l’Empereur Uta 宇多) a sans doute senti cette logique interne de l’emplacement des ḍākinī dans le Maṇḍala ; en tout cas il a cité au début de la section consacrée aux ḍākinī les phrase du Sūtra et du Commentaire qui nomment l’entourage de Yama : “...il est entouré des corbeaux, des vautours et des chacals...” ou “des acolytes des Sept Mères-Déesses, [à savoir] les corbeaux, les renards, les vautours...”(39). Bien qu’il n’ait pas expressément identifié les ḍākinī à ces animaux hantant les charniers, Shinjaku les a considérés sans doute comme leurs remplaçants. Ici aussi, on peut dire que cet auteur a été guidé en quelque sorte par une certaine logique obscure des images mythiques : les ḍākinī ne sont certes pas des animaux, mais elles ressemblent par bien des côtés à des oiseaux de proie, mangeurs de charogne comme le vautour.
Mais ce qui a été décisif pour la suite du développement des croyances japonaises sur les ḍākinī n’a pas été cette association avec les oiseaux, mais bien plus celle qui les a mis ainsi en rapport avec les chacals. Le mot sino-japonais pour le chacal est yegan / yakan 野干 (écrit aussi yegan / yakan 射干), mais il désignait en réalité une sorte d’animal imaginaire ; d’après les citations d’un grand dictionnaire chinois-japonais, le Morohashi, yakan serait un animal qui «ressemble au chien de couleur bleue-jaune [ou selon une autre source, il ressemble au renard, mais plus petit que celui-ci] ; c’est un animal nocif, mangeur d’hommes et capable de grimper aux arbres» (citations du Bencao gangmu 本草綱目 [ouvrage de pharmacopée chinoise, publié en 1590] et du Fanyi mingyi ji 翻譯名義集 [glossaire bouddhique dû à Fayun 法雲, 1088-1158, Ttt. LIV 2131](40). L’autre équivalent que le commentateur chinois du Mahāvairocana-sūtra a glissé en cet endroit, à savoir hu / ko 狐, le renard, a un contenu mythique plus riche encore, car dans l’imaginaire chinois, le renard est un animal magique par excellence ; il a existé beaucoup de contes dans lesquels le renard (ou la renarde ?) se transforme en une belle femme et séduit des hommes (ou au contraire, il se transforme en un bel homme et séduit des femmes) ; il a été en tout cas imaginé comme un animal magique particulièrement luxurieux et sournois ou rusé. Les Japonais ont été sans doute bien friands de cette littérature de contes, et en ont créé aussi eux-mêmes du même genre où le renard joue des rôles essentiels(41).
* *
(1) Il existe au moins une autre sculpture aussi célèbre de cette scène à Elephanta ; celle-ci est cependant si abîmée qu’on ne peut pas distinguer si la ḍākinī est figurée. Voir les réf. ci-dessous, n. 6. Retourner au texte
(2) Sur les ḍākinī en général et surtout dans le bouddhisme, v. l’article “Dakini 荼吉尼” par Guo Liying 郭麗英, à paraître dans le Hōbōgirin, vol. VIII. Retourner au texte
(3) En réalité, cela dépend des contextes. Le japonais (comme le chinois) n’ayant pas la marque de singulier/pluriel des noms, ni d’ailleurs la marque de sexe des noms, on est le plus souvent réduit à conjecturer suivant les contextes. Retourner au texte
(4) Voici une bibliographie succincte de ces études (voir les références complètes dans la bibliographie à la fin de l’article) : Kushida Ryōkō 櫛田良洪, 1964 ; Itō Masayoshi 伊藤正義, 1972 ; Id., 1981 ; Abe Yasurō 阿部泰郎, 1980 ; Id., 1984 ; Id., 1985 ; Id., 1986 ; Id., 1989 ; Id., 1990A ; Id., 1990B ; Id. 1993 ; Yamamoto Hiroko 山本ひろ子, 1987 ; Id., 1993 ; Tanaka Takako 田中貴子, 1993 ; Sakurai Yoshirō 櫻井好朗, 1996 ; Id., 1993 ; Hotate Michihisa 保立道久, 1990 ; Matsuoka Shinpei 松岡心平, 1991 ; Kamikawa Michio 上川通夫, 1989. Retourner au texte
(5) Tttt. LXXVI 2410 xxxix 633c5 : “仁王經ノ以祭塚神事、深可思之”. Retourner au texte
(6) Sur ce mythe et son iconographie, v. Doniger O’Flaherty, 1973, p. 190-192 ; Id., 1975, p. 168-173 et les notes, p. 327-328 ; Stella Kramrisch, 1981, p. 50 : pl. 42 [“Śiva empalant le demon Andhaka” qui est une réplique minuature du bas-relief du temple-grotte No 29 d’Ellora] ; p. 51 : pl. 43 [Tête d’Andhaka/Bhṛṅgin] ; Id., 1992, p. 374-383 ; p. 456-457 ; Charles Dillard Collins, 1988, p. 57-65 ; T. A. Gopinath Rao, 1971, I-2, p. 379-382 ; II-1, p. 192-194 ; Thomas E. Donaldson, 1987, p. 1108-1109, et fig. 3577-3584 ; Tachikawa Musashi 立川武藏, Ishiguro Atsushi 石黒淳, Hishida Kunio 菱田邦男, Shima Iwao 島岩, 1980, pl. 81-84 et p. 84-86, p. 93 [pl. 81 est une photo de la sculpture de la grotte 15 d’Ellora]. Retourner au texte
(7) Selon une indication de S. Kramrisch, 1981, p. 50, cela représenterait un grouillement des petits démons ayant apparu du sang d’Andhaka et foulés au pied par Śiva. Retourner au texte
(8) T. A. Gopinath Rao, 1971, II-1, p. 192-194 et pl. XLV, fig. 2, pl. XLVI-XLVII. Retourner au texte
(9) Les rapports entre l’iconographie de ce maṇḍala et le mythe hindou de la soumission de l’asura Andhaka par Śiva ont été déjà suggérés par Toganoo Shōun 栂尾祥雲, 1982B, p. 340-341, bien qu’il n’ait pas développé pleinement cet argument. Retourner au texte
(10) Cf. Hōbōgirin, VII, s.v. Dairaku 大樂, spécialement p. 943b-946b (Ian Astley, 1994). Retourner au texte
(11) T. VIII 243 785c18-20. Retourner au texte
(12) Ttt. XIX 1003 ii 616a12-13; 24-28. — Le “Sūtra en large” auquel Amoghavajra se réfère doit être le Naya-sūtra en huit rouleaux qui a été traduit en chinois sous les Song : T. VIII 244 iii 796b17-27. Retourner au texte
(13) Cf. par exemple Gōhō 杲寶 dans son sous-commentaire du Naya-sūtra, Tttt. LXI 2241 xi 735a20-23. Retourner au texte
(14) Cf. J. N. Banerjea, 1974, p. 503-506. Retourner au texte
(15) Il existe un mythe du Mahābhārata racontant la naissance de Skanda, dans lequel ce “fils” de Śiva donne aux “Mères” le pouvoir d’«affliger de toutes sortes de maux les enfants jusqu’à l’âge de seize ans» (Cf. M. Biardeau, 1981A, p. 439b). — Sur le culte des “Mères” en Inde, v. Tachikawa Musashi 立川武藏, 1990 (richement illustré). Retourner au texte
(16) Traduit de la traduction anglaise citée par Charles D. Collins, 1988, p. 63. Dans d’autres versions du mythe de la soumission d’Andhaka, Śiva est nommé par exemple Kāla, Kālabhairava, ou Kālāgnirudra (cf. Collins, 1988, p. 61-62, citant des passages du Kūrma Purāṇa). Retourner au texte
(17) Collins, 1988,. 56-57, citant le Meghadūta, st. 33-35. Retourner au texte
(18) Cette description est basée en partie sur celle du Shosetsu-fudō-ki 諸説不同記 TZ. I 2922 x 127a25-b22. Retourner au texte
(19) Ttt. LIV 2128 x 366b14-17. Retourner au texte
(20) Toganoo Shōun 栂尾祥雲, 1982B, p. 340 et n. 2, qui cite la Śrī-paramādyaṭīkā d’Ānandagarbha. Retourner au texte
(21) Biardeau, 1981B, p. 481b. Retourner au texte
(22) Stella Kramrisch, 1981, p. 104 et sq. ; cf. aussi Id., 1992, p. 6-7, p. 40-43, p. 336-340. Retourner au texte
(23) Sur tout ceci, v. D. L. Snellgrove, 1959, p. 8-9, p. 135, etc. ; Id., 1987, p. 160-170 ; Tsuda Shiníchi, 1974, p. 54-60 et sq. ; M.-Th. de Mallmann, 1975, p. 146-149. Cf. aussi Adelheid Harrmann-Pfandt, 1992-93. Retourner au texte
(24) Ttt. XXXIX 1796 x 687b18-c11. La rédaction dans la “recension remaniée” du même commentaire, Dainichi-kyō gishaku 大日經義釋, vii, Z. I, XXXVI 378, verso b11-379 recto a10, est assez différente, mais les grandes lignes du récit restent les mêmes. Cf. aussi les sous-commentaires, par exemple : Jiaoyuan 覺苑, vii, Z. I, XXXVII 91 recto a16-b1 ; Gōhō 杲寶, Tttt. LIX 2216 xxxv 371b17-26, etc. — Sur la conception de la “soumission” dans l’ésotérisme bouddhique, cf. quelques réf. aux travaux de R. A. Stein, dans N. Iyanaga, 1985, p. 739, n. 27 ; et ajouter : R. A. Stein, 1981A, p. 4 et 5 du tiré-à-part. Retourner au texte
(25) Sur l’équivalence “goō = gorocanā, cf. Minakata Kumagusu, 1971, p. 167-168 ; p. 191-192 ; et T. XVIII 901 x 876b17. Retourner au texte
(26) T. XCVIII 3 p. 305c-307a. Retourner au texte
(27) Cf. N. Iyanaga, 1985, p. 688, n. 103. Retourner au texte
(28) Ttt. 1796 xiv 722a28-b2. Retourner au texte
(29) Tttt. LXXVII 2412 v 76a3-21. — On trouvera un texte bien semblable à celui-ci dans l’Asaba-shō 阿娑縛抄, TZ. IX 3190 cxvi 320b19-c26. Retourner au texte
(30) Nous traduisons en général yakan (qui correspond en principe au sk. sṛgāla ou śṛgāla) par “Chacal” et ko 狐 (ou kitsune 狐, shinko 辰狐, etc.) par “Renard” ; mais ces traductions ne prétendent pas à la précision zoologique (d’ailleurs il arrive que 野干 soit lu kitsune en japonais). Ces animaux sont de toute façon des êtres plus ou moins mythiques ou imaginaires, et en japonais, il n’y a pas de distinction très nette entre les deux. Retourner au texte
(31) Cf. Keiran-shūyō-shū, Tttt. LXXVI 2410 xl 634b28-29. Retourner au texte
(32) T[tt]. XIX 945 vii 135b12 ; cf. aussi Tttt. LXI 2234 604b7. Ce passage a été signalé par Michel Strickmann, 1996, p. 157 et n. 69 [à la page 443]. Retourner au texte
(33) T[tt]. VIII 246 ii 840b5-c8 ; cf. l’ancienne “traduction”, T[tt]. VII 245 ii 830a24-b27. Retourner au texte
(34) La citation qui suit ne se retrouve pas dans le Mahāmāyūrī-sūtra tel qu’il est conservé, ni d’ailleurs dans aucun autre texte en notre connaissance. Retourner au texte
(35) Cf. Alain Daniélou, 1960, p. 308-310 ; Stella Kramrisch, 1981, p. 218 et n. 3. Retourner au texte
(36) Marie-Thérèse de Mallmann, 1963, p. 202-203. — Sur les rapports entre Mahākāla et l’ogresse Hārītī, cf. notre article "Daikokuten 大黒天” dans Hōbōgirin, VII, p. 844a-846b, etc. (Iyanaga, 1994). Retourner au texte
(37) T. XVIII 848 v 35a24-b3 ; cf. le Commentaire, Ttt. XXXIX 1796 xvi 744a19-b3. Retourner au texte
(38) De fait, il a existé des arrangements de ce Maṇḍala où Mahākāla et Vināyaka (autre nom du dieu-éléphant Gaṇeśa) étaient figurés à côté du Roi Yama. Cf. Ishida Hisatoyo 石田尚豐, 1975, vol. de Planches, p. 1-9. Retourner au texte
(39) Shosetsu-fudō-ki 諸説不同記, TZ. I 2922 viii 105b27-c1 et sq. — Ce point est développé par Guo Liying dans son article “Dakini 荼吉尼”, à paraître dans le Hōbōgirin, vol. VIII. Retourner au texte
(40) Cf. Dictionnaire Chinois-Japonais de Morohashi, IV, p. 14d (No. 7434 : 24-3) ; XI, p. 432c (No. 40133 : 43). Le mot yakan a été utilisé spécialement dans les traductions des textes bouddhiques comme équivalent du sk. śṛgāla (ou sṛgāla), le chacal ; mais la réalité de cet animal n’était sans doute pas perçue par les Chinois. Ce pourrait être une des raisons pour lesquelles ce mot a fini par désigner un animal imaginaire... Retourner au texte
(41) Cf. Matsumae Takeshi 松前健, 1988B, in Matsumae Takeshi éd., 1988, p. 86-89 ; Kondō Yoshihiro 近藤喜博, 1978, p. 173-176, où l’on peut trouver quelques exemples de ces contes. V. aussi Yoshino Hiroko 吉野裕子, p. 39-68 [sur les renards dans le monde chinois], p. 15-38 [sur les contes japonais relatifs au renard] ; Sawada Mizuho 澤田瑞穗, 1978, p. 171-181. — Sur les croyances relatives au renard en Extrême-Orient, cf. Etudes mongoles et sibériennes, XV [1984], Le Renard. Tour, détours et retours ; sur les croyances japonaise, Anne Bouchy, 1984, p. 17-70, et sur les croyances chinoises, Rémi Mathieu, 1984, p. 83-110 ; Jean Lévi, 1984, p. 111-140. Retourner au texte
Go to Home Page | Go to Articles Index Page
Go to Table of Contents | Go to the Next Page
Mail to Nobumi Iyanaga
This page was last built with Frontier on a Macintosh on Tue, Jun 5, 2001 at 23:55:44. Thanks for checking it out! Nobumi Iyanaga